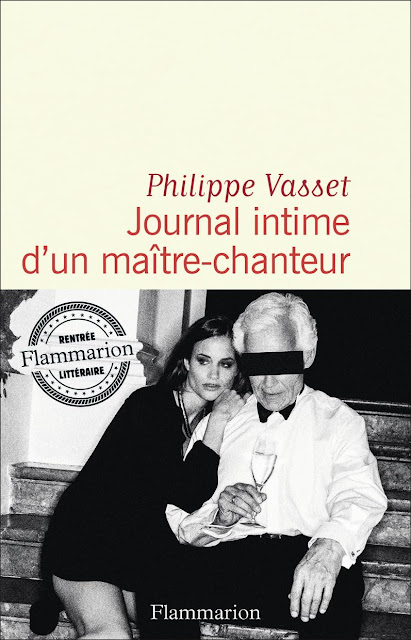Jolie variation littéraire sur les vicissitudes de « L'amour moderne » par Louis-Henri de La Rochefoucauld.
Sous une brillante couverture signée Floc'h, Louis-Henri de La Rochefoucauld, critique littéraire à l'Express, explore ce qu'il reste de l'amour au XXIe siècle. L'amour, à l'heure des nouvelles technologies, est-il moderne ? Pas tant que cela finalement. D'autant que l'auteur se consacre surtout aux amours d'hommes et de femmes du siècle dernier. Ou du moins qui ont débuté leur parcours d'adultes amoureux, à la fin du XXe. Et sans surprise, on se retrouve avec le classique (et pas moderne pour un sou), ménage à trois : le mari, l'épouse et l'amant.
Ivan, écrivain par accident, marié par hasard, divorcé par raison, vivote dans Paris, alignant les pièces de théâtre légères et les succès. Un confort matériel qui lui permet de faire une pause dans sa production. En réalité, cela fait un an qu'il n'arrive plus à écrire, de plus en plus obsédé par un fait divers qui a bouleversé son enfance. Ivan, contacté par Michel, riche et très influent producteur. Il voudrait qu'il écrive un petit chef-d’œuvre pour son épouse, la célèbre actrice Albane, retirée des plateaux depuis de trop longues années après avoir tout remporté, de la palme d'interprétation à Cannes en passant par un oscar et quantité de césar. Michel considère Albane comme sa « chose ».
Cette dernière, exemple même de la femme désirant s'émanciper, a repris des études et cherche plus de spiritualité dans la vie. Ivan, peu habitué aux commandes, est récalcitrant. Mais quand il apprend qu'Albane, un peu plus âgée que lui, est directement liée au drame qui le hante toujours, il accepte l'offre. Juste pour en apprendre un peu plus. La malice du romancier transforme cette relation de travail en cour subtile et délicate. Comme quoi, même moderne, l'amour ne s'épanouit pas sans un minimum d'effort.
Un texte érudit, brillant, léger ; parfait pour comprendre les subtilités de cette étonnante alchimie qui provoque une attirance irrépressible entre deux êtres humains. L'occasion aussi de découvrir les pratiques de ce milieu culturel parisien, souvent boursouflé d'orgueil et de vanité, mais qui parfois est à l'origine d’œuvres mémorables.
« L'amour moderne » de Louis-Henri de La Rochefoucauld, Robert Laffont, 256 pages, 20 €









.jpg)
.jpg)