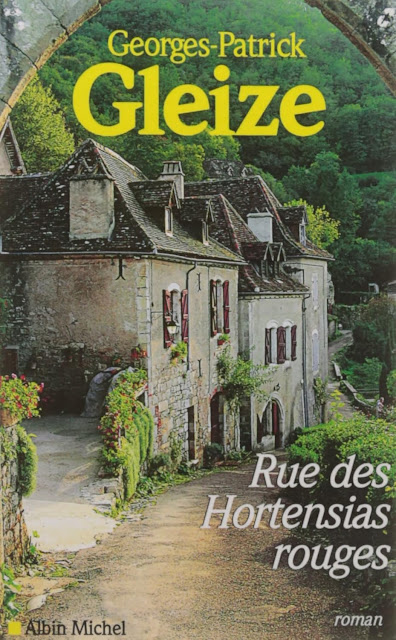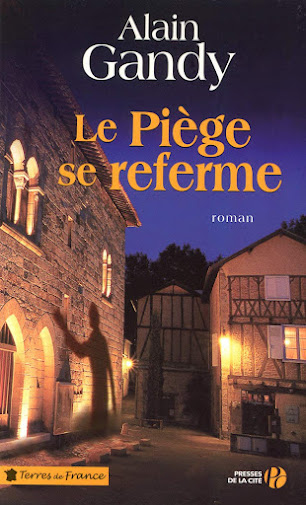Quelques chroniques de livres et BD qui méritent d'être lus et les critiques cinéma des dernières nouveautés. Par Michel et Fabienne Litout
mardi 4 février 2014
Livres - Histoires de bébés et autres romances avec Marie-Bernadette Dupuy
mercredi 20 février 2013
Roman - L'amour, la mer, la mort
mercredi 23 mars 2011
Roman - Quand le rouge était symbole politique
En découvrant l'histoire de sa mère, un commerçant toulousain plonge dans l'histoire contemporaine européenne, de l'URSS à la guerre d'Espagne.
Un étonnant grand écart : c'est le premier sentiment que le lecteur a en refermant ce roman de Georges-Patrick Gleize. Tout oppose les deux personnages principaux de « Rue des Hortensias rouges ». Maxence, le riche commerçant toulousain et Mathilde, sa mère, pasionaria rouge qui a abandonné sa famille par amour et idéal. Maxence c'est le côté grand bourgeois, Mathilde celui de la lutte des classes.Georges-Patrick Gleize, professeur d'histoire, est devenu en quelques années un spécialiste du roman de terroir. Il plante ses intrigues dans le Sud, toujours près de l'Ariège, département où il vit. Une bonne partie de son dernier roman se déroule à Ax-les-Thermes dans les années 30. Mais tout débute à Toulouse. Maxence, riche commerçant toulousain, reçoit la visite d'un enquêteur missionné par un notaire bordelais. Il vient s'assurer qu'il est bien le fils de Mathilde Auzeral. Son unique héritier aussi. Mathilde vient de mourir à Bègles dans la petite maison où elle vivait seule, rue des Hortensias rouges.
Arme et lingots d'or
Sa mère, Maxence ne l'a pas connue. Il était encore au berceau quand elle a abandonné le domicile conjugal. Tout ce qu'il en sait, de la bouche de sa grand-mère, c'est qu'elle « était une écervelée qui l'avait abandonné pour courir le guilledou avec un aventurier de passage. » Intrigué, comme pour retrouver cette maman qu'il n'a jamais connu, il accepte de se rendre à Bordeaux pour s'occuper de la succession. Il découvre le petit intérieur de ce qui semblait être une vieille dame rangée. Elle vivait chichement, entretenant avec soin de superbes hortensias rouges.
La dernière formalité consiste à ouvrir un coffre qu'elle avait à la banque. Maxence y découvre, stupéfait, plusieurs lingots d'or et un révolver de fabrication russe. Et une lettre, d'un certain Fédor, envoyé de Riga. Maxence, voulant absolument tirer toute cette histoire au clair, se rend en Lettonie. Il y rencontre Fédor, un vieillard vivant dans un petit appartement. Il est usé par les années passées dans les camps de Sibérie. Il parle français et se souvient bien de Mathilde. C'est par son récit que Maxence va découvrir la véritable histoire de sa mère.
Bourgeoise et révolutionnaire
Milieu des années 30, Mathilde, fille de bourgeois toulousain, a épousé Jean Auzeral, de 20 ans son aîné. Malade des bronches, la jeune mariée part en cure à Ax-les-Thermes dans les pyrénées ariégeoises. C'est là qu'elle rencontre Fédor Valkas. Ce militant communiste qui a tout sacrifié à sa cause, tombe sous le charme de la jeune Française. Un coup de foudre raconté avec beaucoup de sensibilité par Georges-Patrick Gleize. Mathilde, seule, loin de son mari qu'elle n'aime plus, accepte de déjeuner avec Fédor. « Suspendue à ses lèvres, la jeune femme, les yeux brillants, se gorgeait de ses paroles comme on boit aux sources de la vie. » « Dans les bras de Fédor, Mathilde Auzeral avait dansé jusqu'à l'ivresse. » « Elle avait résisté jusqu'au deuxième tango pour succomber lorsque le souffle de Fédor avait effleuré ses lèvres. » Mathilde découvrait un nouveau monde, fait d'amour et de combat politique.
Elle hésitera longuement avant de quitter le domicile conjugal et rejoindre Fédor, combattant en Espagne. Mathilde sera à Barcelone quand les troupes de Franco mettent en déroute les Républicains. L'auteur raconte la Retirada, cet exode d'Espagnols se réfugiant en France. Puis il y a la guerre, la France envahie par les Allemands, la poursuite du combat de Fédor en URSS. Cette histoire de l'Europe, qui semblait si lointaine à Maxence, se révèle être passionnante car sa mère, loin d'être la dévergondée décrite par la grand-mère, était une pasionaria rouge qui n'a jamais renié ni son amour de Fédor, ni ses idéaux de justice. Un splendide portrait de femme libre.
« Rue des Hortensias rouges » de Georges-Patrick Gleize, Albin Michel, 18 €
jeudi 8 mai 2008
Polar - La famille Combes prise pour cible
Joseph Combes et sa petite famille sont l'objet d'une vengeance. Danger maximum pour l'ancien gendarme de Villefranche-de-Rouergue.
Mais qui peut en vouloir à Joseph Combes au point de tenter d'écraser avec une voiture sa fille, Clairette ? Si les forces de l'ordre de Villefranche-de-Rouergue, dans leurs premières constatations penchent pour un chauffard, Joseph Combes est persuadé lui qu'il s'agit bien d'une tentative d'assassinat. Pour preuve, il reçoit un coup de fil d'un mystérieux interlocuteur lui affirmant que la prochaine fois sera la bonne. Branle-bas de combat dans la famille qui n'entend pas se laisser faire. Clairette est mise au vert chez sa grand-mère à Bergerac et Joseph remonte la piste jusqu'à Figeac. Ce serait là qu'un groupe de comploteurs aurait mis au point un plan pour discréditer l'ancien gendarme devenu détective privé et redresseur de tort.
Alain Gandy a créé le personnage de Joseph Combes en 1997 et « Le piège se referme » est le 12e titre de la série avec ce héros récurrent qui ne cesse d'évoluer au fil des années.
Ancien militaire
Adjudant-chef en mission dans l'Aveyron au début, il s'est finalement installé dans la région, a quitté l'uniforme et s'est mis à son compte pour créer l'agence Combes et cie, officine de détective privé dans laquelle sa femme, la belle et impétueuse Claire, joue un rôle de plus en plus important. Joseph Combes est le prototype de l'ancien militaire, droit dans ses bottes, ayant le sens de l'honneur et une sainte horreur des injustices. Un peu le portrait d'Alain Gandy qui a été militaire dans une précédente vie. Avant de se lancer dans le roman policier rural et de terroir, il a signé quelques romans de guerre et des documents sur la Légion étrangère et même une biographie du général Salan. Mais depuis une dizaine d'années il se consacre exclusivement à Joseph Combes qu'il prend un malin plaisir à plonger dans des intrigues alambiquées où souvent de sombres personnages aux âmes torturées imaginent le pire.
Toute la tribu
Dans ce nouveau roman, c'est toute la famille qui est menacée. Quelques meurtres plus tard (des comparses du méchant sur le point de le trahir), Joseph Combes parvient à identifier l'instigateur du complot. Une vieille connaissance qui a déjà fait du mal à Claire Combes. Une découverte en pleine nuit qui jette un froid. « Le silence revenu avait l'air plus profond qu'avant ce réveil en fanfare. Il était chargé de drames, habité de personnages figés dans les souvenirs, agressifs, violents, cruels, qui avaient partagé avec Claire et Joseph, onze ans plus tôt, un jeu de passions et de morts subites. Dans le doux éclairage de la lampe de chevet, le ménage Combes de cette nuit se sentait revivre les péripéties les plus tragiques de son histoire commune. »
L'action se déroule à Figeac, Villefranche bien entendu mais également à Bergerac. L'ancien militaire devra aller demander de l'aide à un de ses anciens soldats (un montagnard vietnamien) pour contrer le machiavélique plan visant à détruire sa famille.
On appréciera dans cette série de romans, autonomes mais aux ramifications croisées dignes des meilleurs feuilletons, outre le cadre aveyronnais (et lotois) toujours plaisant, les caractères entiers et malgré tout très humains des différents membres de la tribu Combes. Joseph, le héros, laissant parfois la vedette à la fougueuse Claire, à l'effrontée et insouciante Clairette et au petit dernier, Robert, jeune bachelier à l'enthousiasme contagieux.
« Le piège se referme », Alain Gandy, Presses de la Cité/Balland, 18,50 €
samedi 10 novembre 2007
Roman - Vie et mort autour d'un moulin
Un roman du terroir racontant la vie d'Eline et de son fils Anton, minotiers du Quercy, dans la tourmente de la guerre 39-45.
Le Quercy que refait vivre Maryse Batut dans ce roman familial est très proche de l'Aveyron. Et si le temps des moulins et des minoteries sont définitivement révolus, ce n'est pas si loin que cela. A 53 ans, Eline Laborit décide de raconter sa vie. Les grands moments d'une existence simple, mais traversée par bien des malheurs. Elle n'a pourtant aucun regrets. Son prénom original, c'est son père qui le lui a donné. Il voulait un petit gars. Il l'aurait appelé Elie. Ce fut une fille, Eline.
Devenue grand-mère, Eline se souvient pourtant que son père l'a toujours aimée. Peut-être plus que son frère, le garçon tant désiré, arrivé quelques années plus tard. Eline a toujours vécu à Cariac, un petit bourg du Quercy. Son père a quitté la ferme pour construire un moulin sur le Céroux. Eline n'a connu qu'un seul homme dans sa vie, Léo, son mari. Un coup de foudre un soir dans un bal. De cette union naquit Antonin, l'autre personnage principal de ce récit se déroulant essentiellement dans les années 40.
Activité secrète
La première partie est racontée par Eline. Elle plante le décor, présente les principaux personnages. Ensuite c'est Antonin qui prend le relais. Le gamin qui allait pêcher les anguilles est devenu un homme. Il s'est marié, a pris la relève de son père mort quelques années plus tôt. Sa femme, Bella, attend un troisième enfant. Mais depuis quelques semaines, Antonin est de plus en plus absent le soir. Il jouerait à la belote. Bella doute, Eline décide de prendre le taureau par les cornes et demande ouvertement à son fils ce qu'il fait véritablement de ses soirées. Il n'arrive pas à mentir à sa mère et avoue avoir rejoint la résistance. En ce début des années 40, ils sont peu à avoir fait ce choix. Antonin n'a pas de rôle encore important, mais son activité de minotier le met en danger. Il sera finalement dénoncé et devra, du jour au lendemain, prendre le maquis.
Maryse Batut, dans une langue simple, fleurant bon la tradition et la sagesse paysanne, plonge le lecteur dans les affres de cette famille. Enracinée, prête à tout pour défendre son bien, mais également la liberté.
L'amour plus fort que la guerre
Des existences rectilignes, sans heurts, qui doivent tout d'un coup être confronté à l'innommable. Eline raconte comment, peu avant la fin de la guerre, elle a vu les noires fumées au-dessus d'Ouradour-sur-Glane. Un massacre qui aurait pu se dérouler à Cariac. Et puis malgré le conflit, les privations, la peur, la vie continue et l'amour parfois joue des tours. Eline restera fidèle à la mémoire de son mari défunt, mais Anton, une fois dans les forêts en compagnie des autres résistants, rencontre Hélène. La jeune femme s'est engagée après la mort de son mari au combat. Elle veut continuer pour sa mémoire. Comme il y a quelques années entre Eline et Léo c'est le coup de foudre absolu. Anton a déjà une femme, des enfants, mais la passion est la plus forte. Après une première nuit d'amour il raconte : « Je veux m'étouffer dans sa chair généreuse et docile. Nos âmes et nos corps sont en accord parfait. L'un protège l'autre de la force de son amour. Hors du temps et du monde. Je sais maintenant que si notre vie risque d'être brève, elle aura été intense, et je préfère un destin court, beau, extrême, dangereux, même immoral à une existence longue mais médiocre. » Les bouleversements de la guerre risquent d'être fatal à la famille et au moulin. Mais Eline est là pour préserver l'équilibre. Une grand-mère sachant se transformer en patriarche inflexible quand le danger approche.
« Le moulin du Céroux », Maryse Batut, Lattès, 16 €